Accueil > Ecologie > Effondrement > Dennis Meadows : « Le déclin de notre civilisation est inévitable (...)
D’après Reporterre du 03 Mars 2022
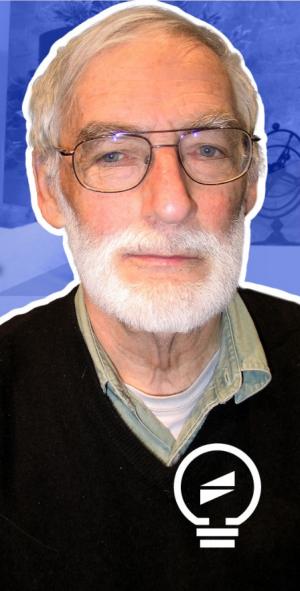 Dennis Meadows : « Le déclin de notre civilisation est inévitable »
Dennis Meadows : « Le déclin de notre civilisation est inévitable »
Par Bruno Bourgeon
jeudi 14 avril 2022, par
Dennis Meadows : « Le déclin de notre civilisation est inévitable »
 Dennis Meadows
Dennis Meadows
Le « Rapport Meadows » a 50 ans. Sa réédition, publiée le 3 mars2022, reste critique : notre monde basé sur la croissance court à sa perte. L’effondrement est une réalité, précise dans cet entretien le chercheur émérite Dennis Meadows, coauteur du texte. Pour lui, « vivre avec moins » est primordial.
Il est même souvent considéré comme l’un des monuments de l’écologie politique. Pourtant, les idées du novateur rapport de 1972 Les Limites à la croissance plus connu sous le nom de « Rapport Meadows », ou « Rapport au Club de Rome » (1), n’ont pas été reprises, ou très peu, par les dirigeants. Il démontrait pour la première fois (2) que l’économie ne pouvait continuer à croître indéfiniment dans un monde fini.
Depuis, les chercheurs à l’origine de ce rapport — dont sa compagne Donella H. Meadows — l’ont plusieurs fois actualisé. Sa dernière version, Les Limites à la croissance (dans un monde fini) (éd. Rue de l’échiquier) , paraît le 3 mars dans les librairies. À l’occasion du cinquantième anniversaire de la publication du rapport originel, voici Dennis Meadows.
Le professeur émérite à l’université du New Hampshire avait 30 ans à l’époque où il a coécrit ce document. Il en a aujourd’hui 79. Entre-temps, le scientifique a donné bien des conférences, rédigé de nombreux livres, reçu d’innombrables prix. Sa conviction que le modèle occidental courait à sa perte, tout comme sa défense d’une sortie planifiée de la surabondance, n’ont jamais failli.
Reporterre — En 1972, le rapport du Club de Rome prévenait les gouvernements qu’ils devaient s’organiser pour éviter un déclin non contrôlé du bien-être humain. Sa réédition de 1992 montrait que l’humanité avait déjà dépassé les limites de la planète. Trente ans plus tard, est-il trop tard pour éviter un effondrement ?
Dennis Meadows —Le terme « effondrement » est un mot très simple, qui a sûrement une signification différente en français et en anglais. Le monde est bien plus complexe que cela. Certaines sociétés, par exemple au Sahel, sont déjà engagées dans un processus d’effondrement.
D’un autre côté, d’autres régions et peuples ne connaîtront probablement pas de grands changements dans les prochaines décennies. Pour autant que nous sachions, le déclin promet d’être plutôt graduel, avec une dégradation progressive de nos ressources naturelles, une pollution progressive de notre eau, etc.
Cela étant dit, en 1972 nous avions encore une chance de ralentir ce processus, du moins théoriquement, et de garder la démographie et la consommation à des niveaux soutenables. Ce n’est plus possible. Nous sommes déjà bien au-dessus de ces limites. D’une manière ou d’une autre, les caractéristiques physiques de notre société vont décliner.
Je me demande souvent si les empereurs romains pensaient qu’ils vivaient un effondrement. Notre empire occidental et néolibéral suit simplement le cycle de vie qui a prédominé au cours des dernières dizaines de milliers d’années. Je ne comprends pas vraiment pourquoi nous imaginons que notre société devrait vivre perpétuellement, et que nous devrions désespérément éviter de la perdre.
Depuis que je suis à la retraite, je lis des ouvrages d’histoire sur l’ascension et la chute des civilisations. Les Phéniciens, les Aztèques, les Romains, les Mongols... Lorsqu’on les étudie, on commence à aborder le déclin des autres de manière plus détendue. Le décès de votre chien bien-aimé peut vous rendre triste, mais vous n’avez jamais imaginé qu’il serait immortel. Le déclin de ma civilisation me rend triste, mais c’est dans l’ordre des choses.
À quoi pouvons-nous nous attendre ?
Ce déclin devrait avoir de nombreuses conséquences sociales et politiques. La croissance, la perspective que tout le monde aura davantage, constitue le fondement du consensus politique dans les démocraties occidentales. C’est moins le cas dans une dictature, où une grande partie des décisions est prise au sommet de l’État.
Lorsque l’on peut dire à un peuple « Si certains d’entre vous se sacrifient, nous pourrons tous avoir davantage plus tard », cela facilite le compromis. Mais si l’on dit, de manière réaliste, « Tout le monde va devoir se contenter de moins, et vous n’aurez plus jamais ce à quoi vous renoncez maintenant », cela engendre des problèmes politiques. Nos gouvernements vont devoir faire avec une population dont la majorité ne sera plus en accord avec ce qui sera proposé. On observe déjà cela aujourd’hui.
Avez-vous des exemples précis en tête ?
Il suffit de regarder les démocraties occidentales. Ce n’est un secret pour personne que l’on assiste aujourd’hui à une envolée du populisme et des gouvernements autoritaires, y compris dans mon pays, les États-Unis. En politique, un seul facteur ne peut jamais tout expliquer.
Mais les limites physiques ont déjà commencé à réduire la capacité à générer de la vraie richesse. Il y a longtemps, des gens comme Henry Ford ont inventé des manières de produire qui créaient de la richesse réelle. Cette époque n’existe plus. Désormais, les élites doivent prendre aux autres pour devenir plus riches. La croissance du PIB se fait aujourd’hui dans le secteur financier, pas dans l’industrie manufacturière, et encore moins dans l’agriculture.
Comment limiter la casse ?
Nous devons faire en sorte que ce déclin se passe de manière paisible, équitable et graduelle. Si nous ne le faisons pas, cela revient à laisser la planète le faire pour nous, et cela promet d’être bien plus destructeur.Je suis frappé par l’incapacité des gens à imaginer un monde avec moins.
Récemment, j’ai dit à quelqu’un que nous devions réduire notre consommation énergétique par deux. Et sa réponse a tout de suite été : « Vous voulez que nous retournions à l’âge de pierre ! » Je lui ai répondu que nous pouvions revenir au mode de vie que nous avions dans les années 1950, où nous utilisions la moitié de l’énergie que nous utilisons aujourd’hui. Ce n’était pas l’âge de pierre.
Jusqu’à présent, l’ensemble des institutions, des politiques, des économistes et des citoyens ont cherché à comprendre comment obtenir davantage. Il y a deux manières d’être heureux : avoir plus, ou vouloir moins. Nous devons déterminer comment vouloir moins.
Cela pose tout un tas de problèmes techniques, en particulier en France, où le système de Sécurité sociale dépend de la productivité d’un grand nombre de personnes. Si nous commencions à comprendre ces choses, cela nous donnerait des options pour limiter la casse.
Comment expliquez-vous que la croissance soit restée l’alpha et l’oméga des dirigeants de la planète, alors que vous avez montré dès 1972 qu’il s’agissait d’une impasse ?
Il est impossible de comprendre le débat sur les limites à la croissance sans réaliser à quel point celle-ci est bénéfique à court terme aux pouvoirs en place. Cela leur donne de la puissance politique et de la richesse financière. Lorsque quelqu’un propose une alternative, ils pensent donc instinctivement que cela leur fera perdre leur pouvoir et leur richesse.
Et bien évidemment, ils y résistent. Beaucoup de dirigeants ont lu les Limites à la croissance, et l’ont perçu comme juste. Mais ils n’ont pas pu en prendre acte. Un jour, l’un d’entre eux m’a dit : « Vous m’avez convaincu de ce que je dois faire. Maintenant, vous devez m’expliquer comment je peux être réélu si je le fais. »
Et, bien sûr, il y a le problème des économistes, notamment aux États-Unis, qui ont construit toute leur carrière sur la notion de croissance infinie. Remettre cela en question reviendrait à dire que leur science est fausse, ou du moins bardée de défauts. Nos élites ont passé leur vie à concevoir la croissance comme la solution à tous les problèmes.
Que pensez-vous de la décroissance ?
Je suis entièrement d’accord avec les réflexions et les objectifs de ce mouvement. Je pense cependant que le choix de son nom était une erreur fondamentale. L’une de mes amies vit au Japon. Elle m’a appelée il y a quelques années pour me dire qu’elle voulait créer une société pour la décroissance. Je lui ai dit « Génial, mais ne l’appelle surtout pas décroissante ».
À la place, elle a créé l’Institut pour la recherche du bonheur humain. Il a exactement les mêmes objectifs, les mêmes thèmes de recherche, les mêmes clients. Et lorsqu’elle appelle le Premier ministre, il lui répond. Elle n’aurait pas passé la réception si elle avait été la présidente de la Société pour la décroissance.
Ce mouvement a tendance à être contre les choses, et non en leur faveur. Il peut mettre en lumière des problèmes spécifiques causés par la croissance et dire que, si nous étions décroissants, nous pourrions nous débarrasser de ces problèmes. Ce mouvement est un merveilleux forum, mais il ne changera pas grand-chose s’il ne parvient pas à partager ses idées avec le reste de la société. Je ne crois pas qu’il y parviendra avec ce nom et cette vision.
La première version du rapport du Club de Rome ne mentionnait pas le climat. Pourquoi ? Qu’est-ce que cet élément apporte à votre compréhension actuelle des limites à la croissance ?
En 1972, notre objectif n’était pas de faire de nouvelles recherches, plutôt d’analyser des données existantes. À l’époque, le changement climatique n’était pas perçu comme problématique. Nous ne le mentionnons qu’une fois dans l’édition de 1972, pour dire que cela promettait de devenir un gros problème.
En 1992, lors de la réédition du rapport, la situation avait changé, il y avait davantage de discussions sur le changement climatique. Il apparaît six ou sept fois. Dans la troisième édition, il y a une quinzaine de références.
Je trouve que le changement climatique est une métaphore parfaite de la difficulté à laquelle nous faisons face : même si de plus en plus de personnes sont conscientes de sa réalité, les émissions de gaz à effet de serre augmentent malgré tout. De la même manière, les gens commencent à comprendre que la croissance démographique est un souci, tout comme la pollution des océans, et pourtant nous ne faisons rien pour y mettre fin.
Le vrai problème, c’est l’excès de croissance physique dans un monde fini. Des symptômes de stress commencent alors à apparaître. Le changement climatique en est un, l’érosion des sols et la pollution des océans en sont d’autres. Bien sûr, il est utile d’essayer de résoudre le changement climatique. Mais cela revient à donner une aspirine à un ami qui a des maux de tête, alors qu’il a un cancer.
C’est utile, mais on ne peut imaginer que cela le guérisse. Même si nous pouvions magiquement arrêter le changement climatique, cela ne résoudrait pas le problème. Il y aurait toujours de la croissance, et les symptômes de stress se manifesteraient d’une autre manière.
Dans la préface de cette nouvelle édition, vous expliquez croire davantage aux stratégies de résilience locales qu’aux négociations internationales pour faire face à ces problématiques. Pourquoi ?
La résilience permet de continuer à vivre malgré les chocs et les surprises. Je me souviens d’avoir donné des conférences à Vienne au début des années 2000. J’expliquais à l’audience qu’au cours des vingt prochaines années, ils connaîtraient plus de changements sociaux, politiques et environnementaux qu’au cours du dernier siècle. Ils ne me croyaient pas. C’est le cas, et le rythme du changement va s’accélérer.
On peut être résilient aux échelles individuelle, communautaire et nationale, par exemple en construisant des pistes cyclables pour que les gens utilisent leur vélo, s’ils ne pouvaient plus utiliser leur voiture. Ce n’est pas le cas pour la durabilité : on ne peut pas adopter un mode de vie durable dans un monde non durable. On ne peut pas s’isoler du changement climatique grâce à nos actions individuelles, par exemple.
Pour vous, les luttes locales sont donc l’avenir de l’écologie ?
Le mouvement écologique a toujours été un mouvement local. J’étais en Hongrie dans les années 1980 : les gens ne protestaient pas contre des obstacles globaux, mais contre l’installation d’un barrage sur le Danube.
Même si le travail de Greta Thunberg suscite de l’attention, ce sont les problèmes locaux, comme les sécheresses, le bruit, la déforestation ou les inondations qui incitent les gens à l’action. Je ne vois pas la possibilité de créer un mouvement écologique global.
Notes :
(1) Publié par les brillants chercheurs de l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT) — Dennis Meadows, Donella H. Meadows, Jørgen Randers et Behrens William W. III.
(2) Les résultats du rapport auraient pu changer le monde. Grâce à un modèle informatique, l’équipe de scientifiques démontrait que la croissance continue de la production industrielle et la pollution qu’elle engendre ne pourraient conduire qu’à un effondrement de la population et des ressources alimentaires. Sans s’aventurer à fixer une échéance précise, ils expliquaient que la croissance devrait commencer à décliner « bien avant 2100 ».
Preuve de la justesse de leur analyse : en 2008, un scientifique australien, Graham Turner, a montré que l’évolution de la situation mondiale au cours des trente dernières années correspondait avec exactitude à leur modèle.
Bruno Bourgeon http://www.aid97400.re
D’après Reporterre du 03 Mars 2022
Version imprimable :
PUBLICATIONS
* Courrier des lecteurs Zinfos974 du
* Tribune libre d’Imaz-Press Réunion du
* Courrier des lecteurs de Témoignages du
* Tribune libre de Clicanoo.re du
* Courrier des lecteurs du Quotidien du
* Libre Expression sur Parallèle Sud du
 AID Association Initiatives Dionysiennes
AID Association Initiatives Dionysiennes